
|
|

|
|
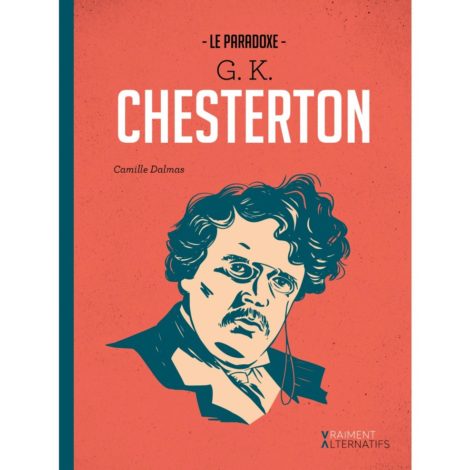
|

|
par Thibault Isabel |
L’homme contemporain vit dans une solitude qui l’étouffe. Les sociologues décrivent cette situation sous le terme d’« anomie ». Notre vie s’est vidée de son sens, parce que nous n’investissons plus l’existence d’une manière active, entreprenante, chargée de liens. Pour retrouver le goût de vivre, nous avons besoin d’une nouvelle société. L’obsession pour la réussite matérielle doit céder le pas à une tension renforcée vers l’humain. Le philosophe Thibault Isabel nous explique pourquoi.
Nous vivons à l’ère du désenchantement technicien. Cela signifie que toute la trame symbolique qui structurait autrefois l’existence des hommes tend à s’étioler. Sous l’effet de la profusion des biens, nous avons perdu le sens de la limite, du manque, de l’interrogation. Nous avons laissé nos repères se perdre, bons ou mauvais, parce que nous ne nous soucions plus de nous diriger, ni de connaître les voies de vertu ou de perdition. L’homme du passé était aussi mesquin et pathétique que quiconque après lui ; mais il avait un sentiment plus clair de la précarité humaine et de la douleur de notre condition. Cela le rendait sans doute modeste, et peut-être aussi, dans certains cas, davantage soucieux de ce qui compte vraiment.
 La pauvreté des relations sociales.
La pauvreté des relations sociales.C’est encore chez ce qui reste de la classe ouvrière qu’on retrouve parfois les conduites les plus dignes d’admiration, précisément parce que les ouvriers sont les seuls à qui il manque encore quelque chose pour être tout à fait épanouis matériellement. Ils tentent donc de compenser leur infortune sociale par des jouissances d’un autre ordre, qui demandent plus d’efforts, mais s’avèrent en définitive plus belles : la camaraderie, le sens de la solidarité, l’amour du jeu sous toutes ses formes…
Ken Loach est certainement le cinéaste qui sait le mieux peindre l’atmosphère de ces milieux, où les travers ne manquent pas, mais qui portent malgré tout la trace surannée d’un monde en train de disparaître : le monde d’avant la technique, d’avant la richesse, d’avant la médiatisation. Un monde qui n’est peut-être déjà plus qu’un souvenir.
La profusion des biens a engendré une certaine anomie sociale, un certain désintérêt pour les liens humains et les préoccupations symboliques.
Ce n’est pas la jouissance des biens matériels qu’il faut réprouver – et toute forme de jouissance demeure même au contraire parfaitement légitime. On peut en revanche regretter que la profusion des biens ait engendré une certaine anomie sociale, un certain désintérêt pour les liens humains et les préoccupations symboliques. Nous n’avons jamais été aussi nantis, et peut-être n’avons-nous pourtant jamais autant couru après l’argent. Ce n’est pas en raison du goût pour le succès économique en tant que tel, mais parce que presque toutes nos autres aspirations ont reflué et que, dans le désert actuel des valeurs, nous n’avons plus que cette oasis après laquelle courir.

D’ailleurs, l’argent n’a pas bonne presse, et nous pourrions au premier abord avoir le sentiment que des valeurs moins superficielles nous animent, si nous avions la naïveté de croire ce qu’on lit en couverture des magazines. Nous sommes friands de « cocooning », plébiscitons les produits issus de l’agriculture « biologique » et avons la nostalgie des modes de vie « traditionnels ». Mais chaque esprit réellement lucide sait bien que la prétendue promotion de la famille, de la nature et de la tradition, c’est-à-dire en fait de la « pureté originelle » et de l’« authenticité », n’est plus qu’une vaine incantation sans consistance, un fantasme qui nous accompagne pour nous consoler d’être désespérément seuls, et qui se trouve d’ailleurs savamment récupéré par la propagande marchande afin de mieux nous enfermer dans notre bulle de consommation.
Parce que nous évoluons dans un monde où les individus se soucient d’abord de leur intérêt immédiat, souvent au détriment des autres, nous nous prenons à rêver d’un havre idyllique où nous serions en sécurité et où nous connaîtrions la douceur d’une existence apaisée. De là découle notre fascination typiquement moderne pour la famille, la nature et la tradition, censées nous apporter de tels bienfaits.
La vie de famille et la confrontation à la nature ne valaient précisément autrefois que par leur âpreté, c’est-à-dire par leur capacité à nous faire intégrer les exigences du réel et le sens des limites.
Mais nous ne comprenons pas que la vie de famille et la confrontation à la nature, effectivement caractéristiques du monde traditionnel, ne valaient précisément autrefois que par leur âpreté, c’est-à-dire par leur capacité à nous faire intégrer les exigences du réel et le sens des limites.
Rien n’est plus difficile, plus périlleux, plus délicat que d’apprendre à vivre avec les autres, dans un cadre de vie frugal et austère ; et rien n’est plus confortable, plus tranquille, plus relâché que de se séparer d’autrui, de se désintéresser du monde et de vivre en autarcie dans une somptueuse tour d’ivoire, à la manière des modernes.

Malheureusement, dans une société où ce confort, cette tranquillité et ce relâchement se généralisent – dans une société de luxe –, l’instabilité sociale devient rapidement telle que nous ne profitons plus d’aucune sécurité. Nous ne faisons plus confiance à personne, au milieu d’un chaos relationnel généralisé, si bien que nous ne jouissons jamais du bien-être auquel nous aspirons pourtant.
Celui qui a le sens de la rigueur, quant à lui, profite malgré tout d’un environnement équilibré. Son amabilité établit des ponts avec ses congénères. Il s’efforce d’être aimable. Sa vie est une lutte contre lui-même et contre ses pulsions désordonnées. Voilà la différence entre une attitude infantile et une attitude adulte. Mais nous avons choisi le camp de l’enfance ; et il n’y a de ce point de vue rien d’étonnant à ce que l’enfance soit maintenant idéalisée avec mièvrerie, alors qu’elle était autrefois considérée comme une étape du développement par où il fallait inévitablement passer, mais qu’il était urgent de surmonter, pour devenir véritablement humain.
Notre fascination contemporaine pour la famille, la nature et la tradition est vide, parce que nous désirons fantasmatiquement y trouver ce qui demeurera en fait toujours étranger à de pareilles notions : la quiétude.
Méfions-nous des sociétés dotées d’une trop grande richesse, car les modes de vie qui s’y développent ont des effets profondément dévastateurs sur la psychologie collective et le tissu relationnel.
Nous répétons par exemple à qui veut l’entendre que la vie familiale est incomparablement précieuse. Mais, dans nos actes, nous n’avons plus même la patience de supporter nos proches et, à la première occasion, nous déménageons loin de notre milieu d’origine pour jouir d’une liberté que nous espérons totale et sans heurts. La famille est le microcosme où nous devrions apprendre à gérer la conflictualité inéluctable de l’existence, et certainement pas un port d’attache où nous nous réfugions par nuit de tempête pour y réparer la coque et les voiles.
Notre vision de la nature et de la tradition est marquée de la même sentimentalité que notre « familialisme » : nous voulons croire à la douceur de la terre nourricière, sans comprendre que la confrontation à notre environnement naturel ou au patrimoine culturel de nos ancêtres est simplement une école de la vie – et une rude école, pour tout dire. C’est pourquoi le caractère moderne, d’inspiration matérialiste, est incompatible avec la mentalité du monde d’autrefois, qui était bien plus pauvre, limité et exigeant que le nôtre, et qui aidait probablement pour cela davantage les hommes à se structurer.
Souhaitons à chacun d’être riche, s’il peut en tirer jouissance. Mais méfions-nous des sociétés dotées d’une trop grande richesse, car les modes de vie qui s’y développent ont des effets profondément dévastateurs sur la psychologie collective et le tissu relationnel.

Jean Baudrillard fut l’un des analystes les plus géniaux de la modernité, et la lecture de ses œuvres doit nous montrer que le principal écueil de notre époque n’est pas l’égoïsme, comme on l’affirme souvent, mais le solipsisme.
L’homme n’est pas plus égoïste aujourd’hui qu’il ne l’était hier ; mais il est seul. Il ne fait donc pas volontairement le mal ; il se désintéresse plutôt du bien et se montre indifférent. Pour mieux dire, il est à la fois plus distancié dans ses haines et dans ses amours. Il est moins féroce, mais s’attache aussi d’une manière moins étroite.
L’homme n’est pas plus égoïste aujourd’hui qu’il ne l’était par le passé ; mais il est seul. Il ne fait donc pas volontairement le mal ; il se désintéresse plutôt du bien et se montre indifférent.
Les sociétés anciennes étaient beaucoup plus violentes que les sociétés actuelles ; les vindictes avaient des répercussions plus graves et la pitié ne semblait guère répandue. N’oublions pas que nous avons presque partout aboli la peine de mort, en Occident, alors que les vendettas familiales débouchaient communément sur des actes terribles, en des temps pourtant encore proches des nôtres, particulièrement dans les campagnes.
Mais, inversement, les rapports humains étaient sans doute beaucoup plus chaleureux. On se froissait vite, on s’invectivait ; et l’on se réconciliait tout aussi rapidement. Les échanges personnels étaient intenses. On aimait parler, discuter. Tout était plus direct et plus franc.

L’entrée contemporaine dans le monde de l’anonymat a été déterminée par bien des facteurs, tant économiques que politiques et sociétaux ; mais le principal vecteur de cette transformation fut incontestablement le développement du système des médias, dont le paradigme est la publicité.
Dans un monde virtuel tel que le nôtre, l’idée de réalité perd de sa pertinence et de son intérêt. L’essentiel n’est plus de savoir ce qu’est une chose, mais comment elle paraît. Le look devient le critère principal de l’identité. Vous pouvez être conformiste ou anticonformiste : dans un cas, vous porterez des chemises Lacoste, et, dans l’autre, des baskets Nike. Mais vous vous agiterez quoi qu’il en soit contre des moulins à vent, parce que tant le conformisme que l’anticonformisme ne renvoient plus qu’à des codes purement extérieurs et superficiels, qui ne signifient en réalité plus rien. Naomi Klein a très bien montré comment de grandes marques s’étaient positionnées au cours des trois dernières décennies pour se donner une image « rebelle » et « contestataire ». Che Guevara lui-même est devenu une sorte d’icône publicitaire, qui s’affiche sur des T-shirts. Dans un pareil cadre, le combat qu’il mena dans la vie réelle pour ses convictions peut-il encore avoir du sens pour les nouvelles générations ?
Vous ne pouvez plus véritablement être athée, parce qu’il n’y a plus de religion. Vous ne pouvez plus « choquer le bourgeois », parce que cela fait longtemps que la bourgeoisie ne s’offusque plus de rien.
A vrai dire, aucune conviction ne peut plus avoir de sens, dès lors qu’il n’y a plus rien à quoi s’opposer. Vous ne pouvez plus véritablement être athée, parce qu’il n’y a plus de religion. Vous ne pouvez plus « choquer le bourgeois », parce que cela fait longtemps que la bourgeoisie ne s’offusque plus de rien. Vous pouvez simplement adopter une posture, un style. Nous vivons dans un monde de valeurs faibles, parce que nous vivons en fait dans un monde de réalité faible. Ce que vous êtes, c’est ce que vous achetez et ce qu’on vous vend.
L’image devient tellement omniprésente qu’elle phagocyte tout. Même la charité tombe sous sa coupe : l’amour chrétien du prochain s’est transformé en larmoiement humanitaire pour les sinistrés du Rwanda de 1994 ou les victimes du grand tsunami de 2004, qu’on oublie aussi vite que les émissions télévisées du mois précédent. Dans le même temps, pourtant, votre voisin meurt de faim ; mais vous ne lui venez pas en aide, non parce que vous êtes cruel, mais parce que vous savez à peine qu’il existe, et parce que vous ne prenez de toute façon jamais le temps de discuter avec lui – sauf peut-être le jour de la « fête des voisins », dont on a largement vanté les mérites dans les médias. La bonté elle aussi s’exprime maintenant sur un mode publicitaire.

Nous devons sortir de ces schémas de comportement et de pensée. Nous devons échapper au monde sordide que les publicitaires ont créé pour nous. Tout ce qui est petit et discret doit retrouver son prestige à nos yeux : la solidarité concrète, les relations de quartier, l’esprit associatif, la coopération économique entre acteurs indépendants. Ne cherchons pas les grands succès ; prisons plutôt les belles initiatives.
Les Cassandre ont raison de dire qu’il s’agit probablement d’un vœu pieux. Mais, à l’heure où tout ce qui se donne pour réel n’a plus que les allures d’un songe, ayons le courage de croire à la réalité de nos rêves. Si nous ne parvenons pas à changer la société, nous aurons du moins rendu nos vies plus stimulantes et plus belles.
A l’heure où tout ce qui se donne pour réel n’a plus que les allures d’un songe, ayons le courage de croire à la réalité de nos rêves.
Toute la difficulté, évidemment, reste de mener une action audible dans un monde qui n’entend plus rien – dans un monde où tout est récupéré, recyclé, réexploité par le marché. Vous ne pouvez pas défendre la solidarité, parce que tout le monde est déjà solidaire, dans son univers solipsiste et virtualisé : même les grandes marques sponsorisent les ONG. Vous ne pouvez pas davantage défendre un authentique réenracinement dans le réel, parce que tout le monde achète déjà des confitures « Bonne maman », fabriquées dans la belle tradition d’autrefois. Quoi que vous disiez, quoi que vous fassiez, votre discours est déjà intégré dans l’ordre de la marchandise, et, plus vous parlerez, plus vous agirez, plus vous prendrez le risque de prolonger le spectacle, c’est-à-dire de pérenniser le système tel qu’il fonctionne.
Pour tenir un discours irrécupérable, il faut avoir le courage de la profondeur, de la patience, de la maturation, de la nuance et de la sobriété. Il faut refuser les modes et les anti-modes. Mais vous sortez alors du système, vous vous marginalisez réellement (plutôt qu’imaginairement) et vous n’êtes plus rien. Vous n’avez plus d’identité pour les autres, puisque vous n’apparaissez plus. Et votre parole n’est dès lors qu’un silence de fait.
Laissons aux fous le bruit et la fureur. Autrefois, dans les monastères, le silence était d’or. Notre révolte silencieuse finira par porter ses fruits.
Thibault Isabel – article publié le 3 octobre 2019 dans la revue « L’Inactuelle ».

En l’espace de vingt ans, le numérique a envahi nos existences, à tel point que nous ne pouvons plus nous passer de notre téléphone portable ou de notre tablette, par exemple pour lire les revues en ligne que nous aimons. Cette nouvelle société technologique est pourtant régie à l’aide d’algorithmes qui anticipent nos comportements et les influencent. Sans nous en rendre compte, nous devenons la proie d’une machine qui empiète sur notre libre-arbitre. Renaud Vignes nous présente les méthodes adoptées par les géants du Net pour encourager nos pulsions d’achat. Il est l’auteur de L’impasse. Etude sur les contradictions fondamentales du capitalisme moderne et les voies pour les dépasser.
Cette génération que l’on appelle les « digital natives » ou la « e-génération », celle que Michel Serres surnomme « Petite poucette » parce que leurs pouces s’agitent en permanence sur leur smartphone, est née avec téléphone ou tablette numérique en main et des écrans devant les yeux. C’est une espèce en voie de mutation, une mutation dirigée par une sélection artificielle : celle où technologies numériques et humaines sont entrées en symbiose. Homo festivus devient homo festivus numericus.
Celui-ci baigne dans les flux de la réalité numérique. Il est indifférent aux autres, ce qui explique son désintérêt pour la chose publique. Il vit dans l’instant et se contente de satisfactions écologiques, d’engagements parcellaires, pour la théorie du genre ou les animaux. Bref, une atomisation du sens civique. Cette dictature du vide se contente d’une offre pressante de produits non indispensables. Le symbole de ces temps narcissiques est le selfie. Tout comme le légendaire Narcisse, festivus numericus est fasciné par son image et informe en temps réel le monde entier de ce qu’il fait. Dorénavant la vie sociale de festivus numericus se passe sur son téléphone portable.
Le symbole de ces temps narcissiques est le selfie. Tout comme le légendaire Narcisse, festivus numericus est fasciné par son image et informe en temps réel le monde entier de ce qu’il fait.
Des signes (like, flamme, cœur…) permettent d’établir une typologie de ses nouvelles relations sociales. C’est le baromètre de la popularité, de l’intégration. Dès le réveil, toute son attention est concentrée sur le développement de cette popularité. Les comportementalistes ont théorisé, il y a déjà longtemps, comment conditionner les êtres humains en s’appuyant sur différentes méthodes de stimulation. S’appuyant sur le puissant besoin d’appartenance de festivus numericus, ces applications jouent sur tous les leviers pour capter son attention. Comme on aide un enfant à lire, à écrire, à être poli, le développement d’une nouvelle science va l’aider à se concentrer sur ce qui est intéressant pour lui.
Cela s’appelle la « captologie » et elle s’est érigée en discipline scientifique. Au carrefour de nombreuses disciplines, ce nouveau champ de recherche est en train de prendre forme autour de la notion d’économie de l’attention. Au sein du Persuasive Tech Lab[1] se développent les recherches les plus avancées dans ce domaine. C’est-à-dire l’étude des technologies numériques comme outil d’influence sur nos comportements. Ce domaine de recherche explore les liens entre les techniques de persuasion en général et les technologies numériques. Cela est devenu une science, qui repose sur les travaux des comportementalistes. Notre cerveau évolue chaque jour, car il est plastique. Plus nous le sollicitons, plus il devient avare d’informations, d’interactions et de stimuli. Un peu comme l’estomac qui grossit quand nous mangeons trop et qui demande encore plus de nourriture pour être rassasié. Cela inclut la conception, la recherche et l’analyse fonctionnelle d’outils numériques créés dans le but de changer les attitudes et comportements des individus. Le terme de « captologie » a été inventé en 1996 par le Dr. Fogg dans ce laboratoire. Il publie en 2003 un ouvrage[2] dans lequel il souligne que la technologie n’est pas seulement un outil, mais également un media et un acteur social.
La captologie a aussi pour ambition d’aider festivus numericus à mieux vivre. Cela peut sembler surprenant : pourtant on estime que, dans l’Union Européenne, 30% des couples se sont rencontrés sur Internet (70% pour les couples homosexuels). De véritables outils de gestion de la vie de famille et de la parentalité sont aujourd’hui disponibles. Des applications mobiles proposent par exemple d’aider à développer l’« intelligence émotionnelle » au sein d’un couple.
Le potentiel de festivus numericus est la clé du système technocapitaliste. Ce qui intéresse celui-ci c’est de détecter automatiquement des potentialités, des goûts, des désirs, bien mieux que nous-mêmes ou nos proches. Les techniques de profilage nous disent ce que nous devons faire. Dans le domaine militaire et sécuritaire, c’est l’exécution par drones armés ou les arrestations préventives de potentiels combattants ou terroristes. Dans le domaine commercial, il ne s’agit plus tant de satisfaire la demande que de l’anticiper. Il devient de plus en plus rare, pour l’individu, d’être exposé à des choses qui n’ont pas été prévues pour lui, de faire l’expérience d’un espace public commun.
Les citoyens ne sont plus identifiés en fonction de catégories socialement éprouvées dans lesquelles ils pouvaient se reconnaître, à travers lesquelles ils pouvaient faire valoir des intérêts collectifs ; ils le sont selon des profils de consommation. Nous intéressons les plateformes, comme Google, Amazon, ou Facebook, en tant qu’émetteurs de signaux utilisables. Ceux-ci n’ont individuellement que peu de sens, ne résultent pas la plupart du temps d’intentions particulières, mais s’apparentent plutôt aux traces que laissent les animaux. Celles-ci alimentent des algorithmes qui repèrent, au sein de ces masses gigantesques de données, des corrélations statistiquement significatives, qui servent à produire des modèles de comportements.
Les citoyens ne sont plus identifiés en fonction de catégories socialement éprouvées dans lesquelles ils pouvaient se reconnaître, à travers lesquelles ils pouvaient faire valoir des intérêts collectifs ; ils le sont selon des profils de consommation.
Il ne nous reste plus rien à dire car tout est toujours déjà « pré-dit ». Les données parlent d’elles-mêmes. Ce qui intéresse les plateformes de commerce en ligne, par exemple, c’est de court-circuiter les processus à travers lesquels nous construisons et révisons nos choix de consommation, pour se brancher directement sur nos pulsions à venir, et produire ainsi du passage à l’acte d’achat, si possible en minimisant notre libre-arbitre.
L’abandon des catégories générales au profit du profilage individuel conduit à l’hyper-individualisation, à une disparition du sujet, dans la mesure où, quelles que soient ses capacités d’entendement, de volonté, d’énonciation, celles-ci ne sont plus requises. L’automatisation fait passer directement des pulsions de l’individu à l’action ; ses désirs le précèdent.
Renaud Vignes
[1] http://captology.stanford.edu/
[2] B. J. Fogg, Persuasive technology: using computers to change what we think and do, The Morgan Kaufmann series in interactive technologies (Amsterdam ; Boston: Morgan Kaufmann Publishers, 2003).

|